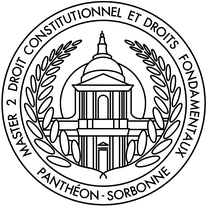Maquette pédagogique
Les enseignements sont, pour l’essentiel, concentrés sur le premier semestre, afin de libérer les étudiants pour la réalisation de leur mémoire de recherche ou expérience professionnelle au second semestre. De nombreux colloques, séminaires, conférences et évènements divers rythment également l’année.
Une réunion de prérentrée est organisée quelques jours avant le début des enseignements, avec un séminaire d’introduction à la méthode de la recherche.
Premier semestre
Le premier semestre se compose des enseignements suivants :
- Droit constitutionnel approfondi (Pr. Xavier Philippe | 24 h) ;
- Théorie des droits et libertés fondamentaux (Pr. Dominique Rousseau | 24 h) ;
- Théorie de la justice constitutionnelle (Pr. Mathieu Disant | 24 h) ;
- Contentieux constitutionnel (Pr. Anne Levade et M. Théo Ducharme | 18 h)
- Système constitutionnel européen (Pr. Anne Levade | 12 h) ;
- Procédure du contentieux de la QPC (Pr. Mathieu Disant | 12 h) ;
- Une option au choix :
- Justice constitutionnelle comparée (Pr. Marie Gren | 12 h)
- Vie politique et des institutions (M. Éric Buge | 12 h).
Second semestre
Le second semestre se compose pour l’essentiel de la réalisation d’un mémoire de recherche ou d’une expérience professionnelle, au choix de l’étudiant.
Quelques enseignements sont néanmoins dispensés au second semestre :
- Droit des institutions de la Cinquième République (Pr. Marie-Anne Cohendet | 24 h) ;
- Statut constitutionnel du pouvoir judiciaire en France (Pr. Bertrand Mathieu | 24 h) ;
- Droit parlementaire (M. Georges Bergougnous | 24 h).
Le mémoire de recherche est soutenu au plus tard début juillet. Le mémoire de stage l’est au plus tard début septembre.
Un grand écrit de droit constitutionnel approfondi, d’une durée de cinq heures, est organisé en fin de semestre, ainsi qu’un grand oral d’une durée de trente minutes, avec quinze minutes de préparation, sur un sujet de droit constitutionnel.
Quels sont les débouchés professionnels ?
Descriptif des enseignements
Droit constitutionnel approfondi (Pr. Xavier Philippe | 24 h)
Le droit constitutionnel face aux mutations politiques et sociales : une remise en cause ?
Ce cours est destiné à replacer le droit constitutionnel dans son contexte et à évaluer le poids de ce dernier dans sa mise en œuvre.
La première partie du cours sera consacrée à une réflexion générale sur les défis que rencontrent les démocraties face à la remise en cause de l’État de droit et au développement de régimes qui construisent leur légitimité sur les fondements de la démocratie mais s’en séparent dans les modes de fonctionnement institutionnels et les valeurs auxquels ils se rattachent. Baptisés parfois « démocratures », cette partie du cours se propose d’engager une réflexion sur les transformations de l’État de droit et les défis auxquels il se retrouve confronté. Elle s’appuiera sur un mécanisme d’analyse de déconstruction et sera orientée vers le droit comparé.
La deuxième partie du cours sera consacrée à l’analyse des « processus constituants et l’écriture des constitutions ». Il s’agira d’examiner en quoi et comment les processus constituants déterminent l’écriture des constitutions mais également d’évaluer comment le résultat lui-même, c’est-à-dire le texte constitutionnel, traduit la volonté des constituants et crée un système constitutionnel nouveau. Cette analyse conduira à explorer les rapports entre pouvoir constituant et processus constituant et à évaluer le caractère fondé ou erroné des théories fondant le pouvoir constituant sur le pouvoir souverain du peuple.
Modalités d’évaluation : grand écrit de cinq heures
Théories des droits et libertés fondamentaux (Pr. Dominique Rousseau | 24 h)
Une théorie constitutionnelle de la démocratie est-elle possible ? La démocratie a-t-elle besoin d’une constitution
Les juristes ont largement abandonné la réflexion sur la démocratie à d’autres disciplines, à l’histoire, à la science politique ou à la philosophie. Hans Kelsen a, sans doute, publié, en 1932, un livre intitulé La démocratie, sa nature, sa valeur, mais il est attribué au Kelsen idéologue, au Kelsen social-démocrate, non au Kelsen juriste et théoricien du droit. Comprendre d’abord les raisons de ce désintérêt de la pensée juridique française pour la question démocratique. Parmi les explications, la longue domination, au cours du XXe siècle, de la science politique sur le droit constitutionnel et la longue influence du positivisme qui imposait aux juristes de s’intéresser à la norme, à la forme juridique, à la procédure d’édiction des normes et de repousser toute discussion sur le contenu, la substance, les valeurs portées par ces normes. L’introduction de la justice constitutionnelle a réveillé les constitutionnalistes qui se disputent maintenant sur la nature politique d’un système constitutionnel où la loi votée par les représentants du peuple est contrôlée par un juge constitutionnel. L’hypothèse proposée dans ce séminaire : dans le contexte actuel d’affirmation des populismes et de démocratie il-libérale, la constitution peut être au principe d’une réflexion renouvelée sur la qualité démocratique d’une société.
Modalités d’évaluation : travail de groupe réalisé dans le cadre du cours
Théorie de la justice constitutionnelle (Pr. Mathieu Disant | 24h)
Contentieux constitutionnel (Pr. Anne Levade et M. Théo Ducharme | 18h)
Cet enseignement se déroule sous la forme de séminaire et sera fondé sur un modèle interactif.
Au premier semestre, après une séance consacrée à des exposés permettant de se mettre au clair sur les enjeux de la discipline, le séminaire prendra la forme d’une QPC fictive dont les différentes étapes structureront le séminaire.
Concrètement, les cinq séances qui lui seront consacrées permettront de rédiger et présenter les mémoires devant la juridiction de renvoi, l’arrêt de la juridiction de renvoi, les plaidoiries devant le Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel et, in fine, les commentaires de la décision.
Au second semestre, il s’agira de prendre les affaires en instance au Conseil constitutionnel et pour lesquelles les décisions disposeront de la seule décision de renvoi : ils devront faire preuve d’imagination juridique et démonter leur aisance oratoire, comme leur bonne connaissance de la jurisprudence constitutionnelle et de la procédure contentieuse.
L’organisation pratique sera précisée lors de la première séance en fonction du nombre d’étudiants, sera la suivante :
– Minimum 2 étudiants plaident la QPC devant le Conseil constitutionnel (auteur de la QPC et éventuel intervenant)
– Minimum 2 étudiants plaident la constitutionnalité de la loi (observation du SGG)
-Deux étudiants rédigent la décision du CC et en amont le dossier documentaire (état de la jurisprudence française, européenne et éventuellement droit comparé)
– En fonction du calendrier, 2 étudiants rédigent le commentaire doctrinal de la décision (soit celle qui aura été proposée en séance, soit celle rendue par le CC entre temps).
Système constitutionnel européen (Pr. Anne Levade | 12h)
Ce cours est bref – 12 heures – et suppose donc que les étudiants rafraichissent leur mémoire sur le droit européen car l’objet n’est pas de résumer le cours général de licence.
Les 12 heures seront articulées autour de deux axes, donc deux parties :
- Les éléments constitutionnels des droits européens (droit de l’Union et CEDH) : peut-on considérer qu’il existe un « droit constitutionnel européen » ou des « droits constitutionnels européens » ?
- L’européanisation des Constitutions nationales.
Le premier cours aura lieu le jeudi 28 septembre 2023 de 10 à 13 h puis les 5, 12 et 19 octobre 2023
Modalités d’évaluation : une épreuve prenant la forme d’un « mini-mémoire » sur un sujet de réflexion soumis par l’enseignant et que les étudiants doivent remettre dans un délai d’un mois.
Procédure du contentieux de la QPC (Pr. Mathieu Disant | 12h)
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est à l’origine d’une jurisprudence relativement abondante du Conseil constitutionnel, comme du Conseil d’État et de la Cour de cassation (décisions de non-renvoi, décisions consécutives aux décisions du Conseil constitutionnel…).
Naturellement, cette jurisprudence est intégralement accessible via Légifrance et, le cas échéant, les sites officiels de ces juridictions.Comme indiqué lors de la première séance, les étudiants procéderont à une veille d’actualité de cette jurisprudence QPC (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat et Cour de cassation), et le cas échéant des normes/pratiques qui concerneraient la procédure QPC.
Cette veille doit s’attacher à mettre en exergue, parmi celles qui le méritent en raison de leur valeur illustrative, leur singularité ou rareté, les modalités d’application des règles procédurales et les éventuelles évolutions de la procédure QPC.
Les apports au fond du droit ne sont pas directement concernés par le séminaire Procédure QPC, mais ils peuvent être évoquées dans la veille en tant qu’ils présentent un intérêt procédural (ex : l’évolution du degré de contrôle opéré sur tel principe peut mériter de figurer dans la mention du droit invocable, ou au titre de l’évolution d’une technique de contrôle).Afin de faciliter le travail d’analyse et de traitement, les étudiants suivront le plan ci-dessous.Ce plan est indicatif. Il n’a vocation qu’à vous guider.
Tous les items ne méritent pas toujours d’être complétés. Ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’ajustements plus fins ou d’adaptations en fonction des éléments relevés dans l’échantillon. Le cas échéant, d’autres items peuvent être ajoutés ou requalifiés.
Deux veilles sont à rendre: l’une au premier semestre (de septembre à décembre) et l’une au second (de janvier à mars). S’ils le jugent utile, les étudiants peuvent travailler par groupe de 2 ou 3.L’objectif de ce travail, outre l’approfondissement des connaissances sur la procédure QPC,est de s’exercer au travail de veille, en maniant les décisions « brutes », avec exhaustivité et régularité.
Justice constitutionnelle comparée (Pr. Marie Gren | 12h)
Évolution de la fonction de la justice constitutionnelle dans la période contemporaine (deuxième moitié du XXe siècle).
Le thème général abordé dans ce séminaire sera celui du rôle des juges dans le système juridique et dans la société.
Le séminaire traitera des cas libanais, équatorien, brésilien et espagnol. Selon l’origine géographique des étudiants présents cette années, nous élargirons plus ou moins le champ de recherche à d’autres juridictions. Les pays étudiés change d’une année universitaire à l’autre.
Le thème central sera l’évolution de la fonction de la justice constitutionnelle dans la période contemporaine (deuxième moitié du XXe siècle).
Modalités d’évaluation : oral
Vie politique et institutions (M. Éric Buge | 12h)
Ce cours de « vie politique et fonctionnement des institutions » est un enseignement s’adressant à des étudiants ayant une bonne connaissance du droit constitutionnel et qui souhaitent appréhender en juristes la matière politique.
Dispensé sous forme de séminaire, il sera consacré cette année à la thématique de l’exemplarité des gouvernants. Après une séance consacrée à la définition de cette notion, il sera l’occasion d’aborder les institutions qui sont consacrées, en France comme plus généralement dans les régimes représentatifs, à la protection des gouvernants (immunités, interdiction du mandat impératif) et à leur contrôle (responsabilité sous toutes ses formes).
Sera abordée dans un second temps la révolution contemporaine de l’exemplarité, qui a vu la pénalisation de la vie politique, la création de procédures nouvelles dédiées au contrôle des gouvernants (déontologiques notamment) et l’instauration d’institutions spécifiques (HATVP, déontologues, parquet financier…). Le séminaire se conclura par une dimension plus prospective, à partir notamment de réflexions de droit comparé.
Modalités d’évaluation : écrit ou oral
Droit des institutions de la Cinquième République (Pr. Marie-Anne Cohendet | 24 h)
Ce cours portera sur les mutations du droit constitutionnel français et comparé. Les étudiants seront invités à rechercher quelles sont les principaux changements que l’on observe en droit constitutionnel ces dernières années, qu’il s’agisse des institutions ou du contentieux. Seront également évoqués dans ce cours :
- Les incidences des questions environnementales en droit constitutionnel, comme les évolutions constitutionnelles :
- renforcement des interactions avec le droit international (général et de la CEDH), le droit administratif et le droit comparé (influence croissante du droit comparé de l’environnement) ;
- interprétation de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel ;
- place privilégiée de certains aspects (contentieux climatiques) tandis que d’autres restent toujours particulièrement négligés (protection de la biodiversité) ;
- conséquences des crises comme le Covid et la guerre sur le droit constitutionnel (droits de l’homme, fonctionnement des institutions) ;
- les mutations institutionnelles :
- l’existence d’une majorité relative à l’Assemblée et ses conséquences sur le fonctionnement des institutions et la structuration des partis ;
- l’évolution de la place des femmes dans les institutions (manifestations et conséquences) ;
- la question du mode de scrutin, avec notamment les nouveaux modes de scrutin proposés comme le jugement majoritaire ;
- l’évolution de la place du référendum (spécialement d’initiative citoyenne) et de la démocratie participative dans les débats sur la réforme des institutions ;
- les relations entre les juges, internes, européens et internationaux, dans divers domaines, etc.
Modalités d’évaluation : s’agissant d’un séminaire, il sera demandé aux étudiants de présenter un exposé, seul ou à plusieurs (15 minutes maxi par personne), sur le thème de leur choix et éventuellement sous la forme d’un jeu de rôles (par exemple mise en scène d’une QPC au CC ou d’un débat au sein de l’exécutif ou entre le PR et les responsables des partis ou Parlement…v. Manuel).
En fonction des effectifs, d’autres exercices pourront être réalisés, comme des notes d’actualité ou de doctrine.
Statut constitutionnel du pouvoir judiciaire en France (Pr. Bertrand Mathieu | 24h)
La réalité du pouvoir juridictionnel sous la Vème République – L’objet de ce cours est de déterminer la place de la justice dans le système institutionnel français.
De l’Autorité reconnue par la Constitution, au Pouvoir revendiqué, la place de la justice doit s’apprécier au regard des fonctions qu’elle occupe et de ses rapports avec les autres autorités ou pouvoirs. Il convient notamment d’expliquer la montée en puissances des juges dans les ordres juridiques démocratiques-libéraux.
C’est à partir de ces fonctions que doit être déterminé le statut constitutionnel des magistrats. De ce point de vue le débat récurrent sur le statut des membres du parquet s’inscrit en fait dans un débat plus vaste sur les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir juridictionnel. Un autre débat tout aussi important est celui qui porte sur la responsabilité des juges.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur la nécessité de distinguer l’autonomie de la justice de l’indépendance des juges.
De ce point de vue le rôle et la place du Conseil supérieur de la magistrature que certains souhaitent transformer en Conseil de justice s’inscrit également dans le débat sur les rapports entre justice et politique.
Droit Parlementaire (M. Georges Bergougnous | 24h)
L’enseignement de droit parlementaire, dont les réformes récentes ou en cours constituent un objet d’observation et d’étude privilégié, n’est ni un cours de science politique sur le Parlement, ni un enseignement destiné à des praticiens de la procédure parlementaire.
Il aborde cette discipline comme une branche du droit constitutionnel, sous un angle tout à la fois institutionnel et contentieux. Il analyse le fonctionnement du Parlement à la lumière tant des dispositions constitutionnelles et organiques que des règles internes et de la riche pratique des assemblées, sous le contrôle vigilant du Conseil constitutionnel, tout à la fois acteur et source du droit parlementaire.
Il a pour ambition de démontrer comment ce droit spécifique constitue une garantie du débat démocratique dont le bon déroulement est une exigence constitutionnelle.