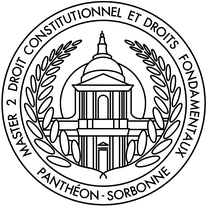Auteur : Hugo Collin Hardy, étudiant en M2 Droit constitutionnel et droits fondamentaux de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Relecteur : Masato Tanaka, doctorant en droit comparé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien étudiant du M2 DCDF
Par un arrêt du 25 octobre 2023, les quinze juges de la Cour suprême du Japon, réunis en formation plénière, ont déclaré unanimement inconstitutionnelle l’obligation légale de stérilisation pour changer de genre sur les registres d’état civil du pays[1]. C’est la douzième fois seulement depuis l’adoption de la Constitution japonaise, en 1946, que la Cour prononce la non-conformité d’une loi au texte suprême[2], alors même que le juge suprême japonais est souvent considéré par la doctrine comme un juge « passif », « conservateur » et « docile »[3].
Il nous semblait important de présenter rapidement cette décision d’ampleur, évoquée par les médias français[4], mais pas encore commentée par la doctrine, en ce qu’elle opère un important revirement de jurisprudence au Japon et invite à reconsidérer les droits des personnes transgenres dans le monde. L’obligation de stérilisation pour changer de genre, imposée par la loi japonaise et confirmée par la Cour suprême en 2019 dans une affaire similaire (I), se voit ainsi finalement déclarée inconstitutionnelle par la même juridiction (II).
I — La stérilisation imposée par la loi et confirmée par la jurisprudence antérieure
L’obligation de stérilisation est d’origine légale (A) et le juge suprême en avait confirmé la constitutionnalité en 2019 (B).
A) Une obligation posée par la loi japonaise de 2003 sur le changement de genre
En 2003, le parlement japonais (la « Diète ») a adopté une loi[5] permettant aux personnes ayant la « conviction psychologique persistante [d’être] d’un genre[6] différent et l’intention de se conformer physiquement et socialement à [ce] genre » de faire modifier la mention de son genre sur le registre d’état civil[7]. Les conditions pour ce faire sont néanmoins plutôt strictes[8]. Outre l’exigence de diagnostic médical de « trouble de l’identité de genre », il est notamment imposé aux personnes souhaitant changer de genre[9] d’être stérile, en ce que la loi exige de « ne pas avoir de glandes reproductrices ou d’avoir des glandes qui ont définitivement perdu leur fonction ». Ces personnes doivent également avoir des organes génitaux externes qui « ressemblent » à ceux du sexe opposé. Ces deux conditions sont en cause dans l’affaire évoquée.
À titre de comparaison, la France, jusqu’en 2016, n’avait ni régime législatif ni régime réglementaire en matière de changement de sexe[10]. Le régime jurisprudentiel construit par la jurisprudence de la Cour de cassation exigeait une opération de réassignation sexuelle qui conduisait, de facto, à la stérilisation[11]. Après une résolution du Conseil de l’Europe appelant les États membres à supprimer les obligations de stérilisation en 2010[12], une circulaire était intervenue la même année pour inciter les juridictions du fond à harmoniser et à assouplir leur jurisprudence en n’exigeant plus l’ablation des organes génitaux d’origine[13]. Néanmoins, la preuve de l’irréversibilité de l’apparence physique, toujours exigée par la jurisprudence[14], impliquait encore une forme d’obligation de stérilisation (par des traitements hormonaux, p. ex.).
Anticipant une nouvelle condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)[15] et après un avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) en 2013 en ce sens[16], la France a adopté un régime de changement de sexe plus souple par une loi de 2016[17]. Désormais, « toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification »[18]. La preuve peut être rapportée par tout moyen et les faits démontrés, peuvent être, par exemple, la « présentation publique » comme appartenant au sexe revendiqué, la connaissance par l’entourage familial, amical ou professionnel sous ce même sexe ou encore l’obtention préalable d’un changement de prénom pour qu’il corresponde au sexe demandé (id.). Il est particulièrement interdit au juge d’exiger « des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation » pour faire droit à la demande[19].
En l’espèce, la condition légale de stérilisation préalable au changement de genre avait été déclarée constitutionnelle en 2019 par la Cour suprême du Japon.
B) Une obligation confirmée par la Cour suprême dans un arrêt du 23 janvier 2019
L’arrêt du 23 janvier 2019[20], rendu par le deuxième petit banc[21] de la Cour suprême japonaise, avait déclaré l’exigence légale de stérilisation conforme à la Constitution de 1946, malgré l’opinion dissidente de deux des cinq juges. La décision reconnaît que la disposition litigieuse limite la liberté de certaines personnes de ne pas subir d’interventions corporelles non désirées. La condition de stérilité n’impose certes pas d’opération médico-chirurgicale de réassignation sexuelle à toute personne transgenre, mais l’impose néanmoins à toute personne transgenre souhaitant obtenir la reconnaissance de son changement de genre sur ses documents officiels.
Dans cette décision, la Deuxième chambre indique néanmoins que la disposition doit être comprise comme vise à prévenir que des personnes transgenres suivent une opération de réassignation sexuelle après avoir eu un enfant, ce qui engendrerait, pour les juges, une « confusion sociale » dans les relations parents-enfants, avec des mères devenues hommes et des pères devenus femmes. La juridiction affirme ainsi défendre la préservation de la stabilité, dans un contexte où le statut de genre est, depuis longtemps, défini en fonction du statut biologique.
Les juges avaient d’ailleurs pu, par de précédents arrêts aux motivations similaires, déclarer constitutionnelles d’autres conditions imposées par la loi de 2003. Ainsi, le 22 octobre 2007, la Cour avait déclaré constitutionnelle l’exigence d’absence d’enfants (mineurs comme majeurs)[22] et, le 30 novembre 2021, la deuxième chambre avait repris ce raisonnement pour affirmer constitutionnelle l’exigence d’absence d’enfants majeurs[23], une loi de 2008 étant venue entre temps amender la disposition en question (cf. infra). De même, l’exigence de célibat avait été déclarée constitutionnelle le 11 mars 2020 par la deuxième chambre[24] pour des raisons idoines.
L’arrêt du 23 janvier 2019 n’était toutefois pas unanime. Deux des cinq juges de la deuxième chambre[25] avaient exprimé une opinion dissidente conjointe, reprise et développée ensuite par l’arrêt du 25 octobre 2023. L’opinion soutient que la loi de 2003 doit être interprétée comme visant à atténuer la souffrance associée à la dysphorie de genre et à résoudre les obstacles sociaux auxquels font face les personnes transgenres. Citant les lignes directrices de la Société japonaise de psychiatrie et de neurologie, il affirme que l’opération chirurgicale de stérilisation n’est plus considérée, en 2019, comme la dernière étape du traitement de la dysphorie de genre, mais plutôt comme l’une des options disponibles, à la discrétion du patient et en fonction de ses symptômes.
Les juges dissidents insistent sur le fait que la stérilisation constitue une grave intrusion dans le corps humain, présentant des risques pour la vie et le corps, avec des conséquences irréversibles sur la perte des fonctions reproductives. La décision de subir une telle opération devrait être donc être laissée au libre arbitre de l’individu, conformément à la liberté de ne pas subir d’invasions corporelles non désirées, garantie par l’article 13 de la Constitution japonaise.
Les juges notent également que la nécessité d’une telle disposition légale s’est vue réduite par l’évolution des circonstances. Ils citent en ce sens la révision législative de 2008, laquelle a permis d’assouplir la condition de n’avoir aucun enfant en n’exigeant plus que l’absence d’enfants mineurs pour changer de genre, malgré une décision de conformité rendue l’année précédente (cf. supra). Ils soulignent également que la société japonaise a fait des progrès significatifs concernant la sensibilisation aux problématiques de transidentité et l’acceptation des personnes transgenres, ce qui justifie, à leurs yeux, une compréhension plus approfondie de leur individualité.
« Nul ne peut aller jusqu’à conclure que la disposition est en violation de l’article 13 de la Constitution du Japon, mais il est indéniable que des doutes se posent sur l’existence d’une telle violation », arrête l’opinion. Citant la position conjointe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations internationales[26], l’arrêt de la CEDH rendu en 2017[27] ainsi que le changement de législation dans un nombre croissant d’autres États[28], l’opinion invite la société et le législateur[29] à faire preuve de « compréhension approfondie » face à la détresse des personnes transgenres pour faire respecter leur personnalité et leur individualité.
Quatre ans plus tard, l’arrêt du 25 octobre 2023 valide aujourd’hui le raisonnement de ces deux juges.
II — La stérilisation déclarée inconstitutionnelle par l’arrêt du 25 octobre 2023
Réunis en assemblée plénière, les quinze juges de la Cour suprême du Japon ont cette fois affirmé, à l’unanimité, l’inconstitutionnalité de l’exigence de stérilisation pour changer de genre à l’état civil[30]. Cet important revirement de jurisprudence reprend partiellement l’argumentation de l’opinion dissidente de 2019 et procède à une forme de contrôle de proportionnalité (A). Au-delà du consensus sur la censure de cette disposition, trois opinions dissidentes appellent à déclarer également inconstitutionnel le critère d’apparence sexuelle, tandis qu’une opinion complémentaire appelle le législateur japonais à une meilleure considération des droits des personnes transgenres (B).
A) Un arrêt édifié sur l’opinion dissidente de 2019 et structuré autour d’un contrôle de proportionnalité
Dans une décision fouillée[31], les hauts juges commencent par indiquer que l’« identité légale de genre », ou « sexe légal », est basée sur le sexe biologique et que, par conséquent, cela est source d’« inconvénients sociaux » pour les personnes transgenres, lesquelles peuvent se voir forcées de révéler leur « trouble de l’identité de genre » dans certaines situations comme la recherche d’emploi et peuvent également ne pas être traitées dans leur vie sociale conformément à leur identité de genre.
Les juges évoquent ensuite la liberté de chacun de ne pas subir de lésions corporelles contre son gré, laquelle serait une composante du droit à la vie, garanti par l’article 13 de la Constitution japonaise de 1946[32]. Ils précisent que la gonadectomie (opération chirurgicale de stérilisation) est « une invasion grave du corps avec des conséquences irréversibles » et que, si la loi de 2003 n’oblige pas toute personne transgenre à subir une telle opération, elle y contraint néanmoins toute personne souhaitant voir modifier son genre sur le registre d’état civil, ce qui constitue une « grave restriction » à la liberté susmentionnée.
Effectuant un contrôle de proportionnalité[33], les juges affirment que la nécessité d’une telle restriction s’est vue réduite par l’évolution des circonstances depuis l’adoption de la loi en 2003. Reprenant et développant l’opinion dissidente de 2019, ils s’appuient sur différents éléments japonais et internationaux, tels que la loi nippone de 2023 visant à améliorer la compréhension publique de la diversité dans l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la recommandation conjointe de l’OMS et d’autres organisations internationales, publiée en 2014 (op. cit.), la onzième révision de la classification internationale des maladies de l’OMS en 2022[34] ou encore un arrêt de la CEDH de 2017 (op. cit.).
Précisant qu’une telle opération n’est pas nécessaire au bien-être de toute personne transgenre, l’Assemblée plénière affirme que l’opération de stérilisation doit avant tout relever d’un choix personnel et que cette opération n’est plus considérée aujourd’hui comme la dernière étape d’un traitement médical, mais comme une forme de traitement parmi d’autres, traitement qui doit être adapté à chaque patient. L’exigence de stérilisation est devenue « médicalement impertinente » selon la Cour, laquelle affirme également qu’il n’a pas été prouvé que l’existence de « père féminin » ou de « mère masculine » provoquerait des confusions dans la société. La restriction lui semble excessive en ce que les personnes transgenres se voient contraintes de choisir entre renoncer à leur liberté de ne pas subir de lésions corporelles afin de pouvoir prétendre au changement officiel de genre et abandonner « l’important bénéfice légal » que peut leur apporter ce changement de genre. La restriction n’est donc ni nécessaire ni « raisonnable »[35] aux yeux de l’assemblée, laquelle conclut à la violation de l’article 13 de la Constitution.
Il est intéressant de noter que la décision ne se fonde pas sur l’article 14 de la Constitution japonaise[36], lequel protège l’égalité devant la loi et prohibe les discriminations, mais uniquement sur le droit au respect de l’intégrité physique, ici vu comme une composante du droit à la vie (art. 13). Or cela n’est pas évident, en ce que le texte constitutionnel reste muet quant à l’existence d’un tel droit au respect de l’intégrité physique. Il s’agit d’une interprétation, d’une conception du droit à la vie, « droit aux contours incertains »[37], qui peut être discutée[38].
Les juges ne condamnent pas néanmoins l’exigence d’avoir des organes génitaux qui « ressemblent » à ceux du sexe opposé, mais seulement celle de stérilisation forcée. Les différentes opinions dissidentes et complémentaires vont toutefois plus loin, en affirmant également inconstitutionnel le critère d’apparence sexuelle externe au genre opposé et en invitant le législateur japonais à une révision d’ensemble de la loi de 2003.
B) Un arrêt unanime qui cache des opinions divergentes
Soutenant l’inconstitutionnalité de la stérilisation forcée, trois opinions dissidentes, émises par différents juges[39], soutiennent que l’apparence sexuelle externe exigée par ailleurs par la loi de 2003 serait également inconstitutionnelle. Selon les juges, l’intérêt protégé par ce critère serait celui, pour autrui, de ne pas voir les organes génitaux du sexe opposé contre sa volonté. Tout en affirmant justifiée la protection de cet intérêt, les juges considèrent que celui-ci est déjà protégé par le délit d’atteinte à la pudeur[40] et le respect, par les personnes transgenres, d’ailleurs très peu nombreuses, de « l’ordre traditionnel japonais ». Par conséquent, le risque que se présente une telle situation paraît très faible aux yeux de ces juges, quand bien même le critère susmentionné serait également déclaré inconstitutionnel.
En outre, une opinion complémentaire émise par le juge Masaaki Oka appelle le législateur japonais à revoir l’ensemble de la loi de 2003 afin d’améliorer les droits des personnes transgenres. Approuvant le sens de la décision de la Cour, il « tient à préciser » que la disposition litigieuse a pu sévèrement affecter un nombre relativement important de personnes et que, dans l’affaire d’espèce, la requérante devrait voir sa demande accueillie. Le juge appelle également le pouvoir législatif à exercer son pouvoir discrétionnaire « de manière raisonnable » quant à l’éventuelle introduction de nouvelles exigences moins restrictives pour changer de genre.
Cela pose question : qui, du juge ou du législateur, doit faire progresser les droits de l’homme ? Une certaine conception de l’État de droit pourrait plaider en faveur du premier, garant des droits et libertés, tandis que la légitimité démocratique du second semble plus affirmée face au sempiternel risque de gouvernement des juges[41].
Enfin, n’oublions pas que, malgré certaines améliorations[42], faire valoir ses droits reste, pour les personnes transgenres, un combat quotidien partout dans le monde. Au Japon, les exigences de diagnostic médical, d’organes génitaux à « l’apparence » de l’autre sexe, de célibat, de majorité et d’absence d’enfants majeurs restent ainsi en vigueur, même si elles peuvent être questionnées à l’égard de ce nouvel arrêt de la Cour suprême.
[1] Cour suprême du Japon, arrêt n° 2020 (Ku) 993 du 25 octobre 2023 [en japonais].
[2] Les décisions d’inconstitutionnalité précédentes ont été prononcées le 4 avril 1973, le 30 avril 1975, le 14 avril 1976, le 17 juillet 1985, le 22 avril 1987, le 11 septembre 2002, le 14 septembre 2005, le 4 juin 2008, le 4 septembre 2013, le 16 décembre 2015 et le 25 mai 2022.
[3] BERIDOT Nathan, « Le contrôle de constitutionnalité des lois par la Cour suprême japonaise », Revue internationale de droit comparé, n° 4, 2020, p. 975-998 ; v. également, MATSUI Shigenori, « Why is the Japanese Supreme Court so Conservative? », Washington University Law Review, vol. 88, n° 6, p. 1375–1423, 2011, LAW David S., « The Anatomy of a Conservative Court: Judicial Review in Japan », Texas Law Review, vol. 87, p. 1545-1594 et RAMSEYER J. Mark, Eric B. RASMUSEN, « Why Are Japanese Judges so Conservative in Politically Charged Cases? », The American Political Science Review, vol. 95, n° 2, p. 331–344.
[4] P. ex., v. Axel NODINOT, « Japon : la stérilisation des transgenres jugée inconstitutionnelle », L’Humanité, 26 octobre 2023 ; « Japon : décision de justice très attendue sur le changement d’état civil des personnes transgenres », La Croix, 25 octobre 2023 ; « Japon : la Cour suprême juge “inconstitutionnelle” l’obligation de stérilisation pour officialiser un changement de sexe », Challenges, 25 octobre 2023 ; « Le Japon juge “inconstitutionnelle” l’obligation de stérilisation des personnes transgenres », 20 Minutes, 25 octobre 2023 ; « Au Japon, l’obligation de stérilisation pour les personnes transgenres jugée “inconstitutionnelle” », Libération, 25 octobre ; « Japon : la Cour suprême juge “inconstitutionnelle” l’obligation de stérilisation pour officialiser un changement d’état civil », France TV Info, 25 octobre… à la suite d’une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP).
[5] Act on Special Cases in Handling Gender for People with Gender Identity Disorder, Act No. 111 of July 16, 2003, art. 2 and 3 (1) [Traduction en anglais par le ministère de la Justice japonais, disponible sur le site web Japanese Law Translation].
[6] Le japonais ne différencie pas le sexe du genre : il utilise le terme « 性別 » (seibetsu) pouvant signifier, selon le contexte, l’un ou l’autre. Les choix de traduction ici opérés sont ceux de l’auteur.
[7] Il est généralement admis par la sociologie que le genre, « sexe social », désignerait un ensemble de caractéristiques socialement attribuées à des groupes supposés distincts, que sont généralement les hommes et les femmes, et s’opposerait en ce sens au sexe biologique (Camille MORIO, « Genre », dans Dictionnaire d’administration publique, 2014, p. 242-244).
[8] Seuls peuvent changer de genre les célibataires sans enfant mineur, de plus vingt ans, s’identifiant de manière permanente au genre opposé, étant diagnostiqué comme « souffrant de dysphorie de genre » par au moins deux médecins différents, ayant des organes génitaux externes qui « ressemblent » à ceux du sexe opposé et étant stérile (art. 2 et 3, § 1).
[9] Pour ce qui est de la procédure, la demande de changement de genre doit être présentée au tribunal des affaires familiales, accompagnée d’un certificat médical, dont le contenu est précisé par le ministère de la Santé. Le certificat doit notamment indiquer « le progrès et les résultats du traitement médical » (art. 3, § 2).
[10] Contrairement au japonais, le français distingue « sexe » et « genre ». La loi française se référant exclusivement au « sexe », cette terminologie sera ici conservée pour décrire le système français.
[11] C. cass., ass., 11 décembre 1992, « René X » (n° 91-11.900), publié au Bulletin : « lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son État civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ».
Pour un arrêt ayant condamné la France au motif justement que la requérante avait subi une opération chirurgicale de conversion sexuelle ayant « entraîné l’abandon irréversible des marques extérieures du sexe d’origine », voir CEDH, plén., 25 mars 1992, B. contre France (req. n° 13343/87).
[12] Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, résolution n° 1728 du 29 avril 2010, « Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre » : « l’Assemblée appelle les Etats membres (…) à garantir dans la législation et la pratique les droits [des personnes transgenres] (…) à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale » (al. 16.11.2).
[13] Circ. 14 mai 2010, DACS n° CIV/07/10, relative aux demandes de changement de sexe à l’état civil : « vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ».
[14] C. cass., 1re civ., 13 février 2013 (n° 11-14.515).
[15] CEDH, 5e sec., 6 avr. 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France (req. nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13).
[16] CNCDH, assemblée plénière, avis du 27 juin 2013 sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil (NOR : CDHX1320077V ; JORF n° 0176 du 31 juillet 2013) : « la CNCDH demande que soit mis fin à toute demande de réassignation sexuelle, que celle-ci passe par un traitement hormonal entraînant la stérilité ou qu’elle signifie le recours à des opérations chirurgicales ».
[17] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 56.
[18] C. civ., art. 61-5.
[19] C. civ., art. 61-6.
[20] Cour suprême du Japon, arrêt n° 2018 (Ku) 269 du 23 janvier 2019 [traduction non officielle en langue anglaise sur le site de la Cour].
[21] Les trois « petits bancs » désignent les formations restreintes de la juridiction, composées chacune de cinq juges et équivalent, en France, aux chambres de la Cour de cassation ou de la section du contentieux du Conseil d’État. Par opposition, le « grand banc » est la formation plénière. Les appellations « chambre » et « assemblée plénière » semblent également en usage (Shigemitsu DANDO, « La Cour suprême du Japon », Revue internationale de droit comparé, 1978, vol. 30, n° 1, p. 155-170).
[22] Cour suprême du Japon, arrêt n° 2007 (c) 759 du 22 octobre 2007
[23] Cour suprême du Japon, troisième chambre, arrêt n° 2020 (Ku) 638 du 30 novembre 2021 [en japonais].
[24] Cour suprême du Japon, deuxième chambre, arrêt n° 2027 (k) 791 du 11 mars 2020 [en japonais].
[25] Kaoru ONIMARU et Mamoru MIURA.
[26] OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO, “Eliminating forced, coercive and otherwise involountary sterilization – An interagency statement”, Geneva, 2014.
[27] CEDH, 5e section, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France, requêtes nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13.
[28] Ont supprimé l’exigence de stérilisation pour changer de sexe (liste non exhaustive) : l’Argentine en 2012, la Suède en 2013, le Danemark et les Pays-Bas en 2014, l’Irlande et la Colombie en 2015, la Norvège et la France en 2016.
[29] Arrêt précité, dernier paragraphe.
[30] Op. cit.
[31] 36 pages en japonais, soit environ XX pages en anglais. Précisons que le modèle organisationnel de la justice constitutionnelle japonaise est plutôt d’inspiration étasunienne, avec une Cour suprême, mais la rédaction des arrêts est plutôt de culture européenne, assez proche de la rédaction de la CEDH ou du Tribunal constitutionnel espagnol, par exemple, plus que du style narratif étasunien.
[32] “All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.” [traduction par le cabinet du Premier ministre japonais]
[33] Le contrôle de proportionnalité est issu entendu comme étant la vérification par la juridiction que l’atteinte que porte l’application de la règle de droit interne (ici, la disposition litigieuse de la loi de 2003) à un droit fondamental garanti par une convention internationale ou par une norme nationale (le droit à la vie garanti par l’article 13 de la Constitution japonaise) n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par cette règle. Ce contrôle, effectué par la Cour suprême japonaise, s’il est comparable à celui d’autres juridictions (p. ex. CEDH, C. const. fr. ou Tribunal constitutionnel espagnol) n’en est pas moins différent en certains aspects. Pour approfondir ce sujet, v. p. ex., Mamiko UENO, Constitution, justice et droits fondamentaux au Japon, thèse de doctorat en droit public (dir. Thierry SERGE RENOUX), soutenue en 2006 à l’université Aix-Marseille 3 ; pour comp., Xavier PHILIPPE, Contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises, thèse de doctorat en droit (dir. Charles DEBBASCH), soutenue en 1989 à Aix-Marseille 3, publiée en 1990 par Economica et par Presses universitaires d’Aix-Marseille.
[34] OMS, Onzième révision de la Classification internationale des maladies, 2022. Notons que la révision de 2019 avait déjà retiré le « trouble de l’identité de genre » du chapitre sur les troubles mentaux.
[35] La traduction est nôtre est peut se révéler inexacte : en japonais comme en anglais, le raisonnable et le rationnel peuvent se confondre.
[36] « All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin. » [idem]
[37] Frédéric SUDRE, La convention européenne des droits de l’homme, PUF, coll. « Que sais-je ? », juin 2004, 6e éd., 126 p.
[38] Par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) de 2000, consacre expressément un droit autonome « à l’intégrité physique et mentale » de toute personne (art. 3, § 1), juste après avoir proclamé le droit à la vie (art. 2, § 1) tandis que la jurisprudence de la CEDH considère que l’intégrité physique des personnes, laquelle n’est pas mentionnée en tant que telle par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (Conv. EDH), est protégée à la fois par le droit à la vie, garanti par l’article 2, l’interdiction de la torture (art. 3) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).
[39] Mamoru MIURA, Koichi KUSANO et Katsuya UGA.
[40] Code pénal japonais, art. 174.
[41] P. ex. pour une illustration des nombreuses critiques de la CEDH à ce propos, v. Eric CONAN, « La CEDH, ce machin qui nous juge », Marianne, le 5 juillet 2014 ; pour un article universitaire récent et de qualité sur la place du juge dans la démocratie, v. Anne-Marie LE POURHIET, « Gouvernement des juges et post-démocratie », Constructif, 2022/1, no 61, p. 45-49.
[42] ILGA World, Trans Legal Mapping Report, 3e édition, 30 septembre 2020 [en anglais].
Par exemple, le ministre de l’Éducation nationale français a émis, le 29 septembre 2021, une circulaire « pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire » (NOR : MENE2128373C) permettant, entre autres, l’utilisation d’un prénom d’usage à l’école.