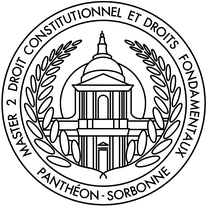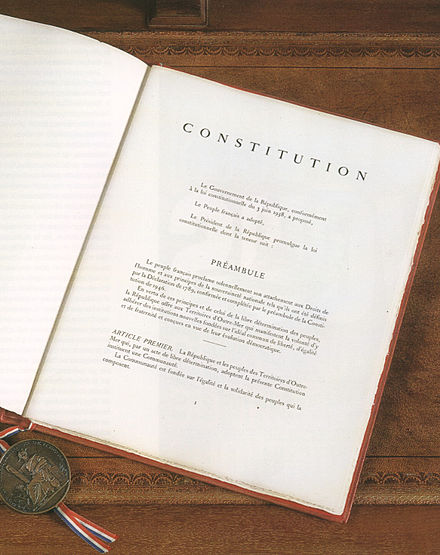Brève analyse des espoirs et des échecs
d’un nouvel amendement de la constitution du 4 octobre 1958
Résumé : A l’occasion de la nuit du droit, le 4 octobre 2023, le président de la République a rappelé sa volonté de réformer notre constitution. Derrière l’effet d’annonce, une détermination marquée depuis son entrée en fonction. Décryptage de ses tentatives ratées ou transformées.
Par Paul Vassal
Étudiant du Master 2 Droit constitutionnel et droits fondamentaux, Président de l’A.E.D.C., et Vice-Président de l’Association des publicistes de la Sorbonne.
« J’ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l’Assemblée nationale et le Sénat« ,
Déclaration du président Emanuel Macron[1]
Le président de la République Emmanuel Macron affiche une détermination depuis son premier mandat à effectuer un amendement de la Constitution. Il reste sur un bilan composé d’une première tentative d’amendement abandonnée ; d’une deuxième tentative d’amendement rejetée ; et d’un dernier projet qui fut évoqué lors d’un discours à la réussite incertaine face aux contestations parlementaires comme populaires. L’observation de ces trois moments constitutionnels, nous permettent d’offrir une représentation des caractéristiques du régime de la Ve République et des dérives contemporaines de la notion de Constitution.
Sans retracer l’histoire constitutionnelle de notre pays, l’amendement de la Constitution représentait un symbole fort pour un Président en exercice. La réforme signifiait un accord trans-partisan, souvent synonyme d’un soutien du peuple, le référendum, ou des représentants de celui-ci, majorité des 3/5èmes du Congrès. A l’inverse, le rejet est synonyme d’un échec pour le projet politique développé par le président. Cet échec pourrait entrainer le recul de la politique proposée pour de nombreuses années et/ou sa démission[2]. Aujourd’hui, la symbolique de la révision a diminuée, elle n’a plus force « d’un sacrement ou d’un sortilège[3]», elle est devenue un usage « presque banal[4] ». Notre Constitution qualifiée de rigide du fait de ses procédures contraignantes fut révisée vingt-quatre fois, et si la volonté du président s’accorde avec le Parlement, pour une vingt-cinquième fois.
Cependant, cette banalisation de la révision ne veut pas dire qu’il soit aisé de réviser notre Constitution. En effet, la révision constitutionnelle qui concernait l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité et le renforcement du parlement de 2008 n’a été acquise que par une majorité d’une voix[5]. De surcroît, depuis 2008, l’ensemble des réformes constitutionnelles proposées ont toutes échouées. Cet échec est le résultat d’une conjoncture défavorable aux présidents de gauche et centriste. Cette conjoncture est représentée par un Sénat à droite, et des minorités – de tout bord – bousculant la majorité élue[6]. L’annonce effectuée devant le Conseil constitutionnel, au jour de l’anniversaire de la Constitution la plus stable de notre histoire, n’est pas anodine. Elle nous amène à devoir décrypter ce Momentum constitutionnel décomposé en deux instants qui ont des conséquences importantes pour la matière constitutionnelle.
* *
*
I. Le premier temps constitutionnel s’est déroulé en 2019, un ensemble de trois textes (constitutionnel, organique et ordinaire) est établi par le gouvernement. Le Conseil des ministres décide de déposer un projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale pour être débattu, dans l’objectif de proposer un renouveau démocratique. Ce projet fut rapidement arrêté par les difficultés extra-juridiques secouant les membres proches de la présidence de la République, alors que cette dernière devait déjà tempérer une crise politique sans précédent[7]. De ce texte délaissé qui rejoint la myriade de projets d’amendements constitutionnels oubliés, deux éléments nous interpellent :
Dans un premier temps, c’est son contenu novateur qui abordait concrètement le renouveau démocratique demandé depuis longtemps par les citoyens. Ce projet ambitieux de 13 articles avait pour objectif de modifier de manière transversale les caractéristiques du régime de la Vème République. C’est le cas de la question environnementale avec l’introduction au sein de l’article 1er de notre Constitution de la « préservation de l’environnement »[8]. La proposition de réforme incorporait également l’amélioration des outils référendaires pour permettre une meilleure participation citoyenne par deux innovations ; la première innovation consiste dans l’abaissement de la limite matérielle du seuil pour le référendum d’initiative partagé (d’un dixième des électeurs à cinq pour cent, soit de quatre millions à un million) ; la seconde innovation se loge dans l’élargissement des sujets pour le référendum de l’article 11 (« l’organisation des pouvoirs publics territoriaux et aux questions de société », hors fiscalité ou pénal)[9]. En outre, la réforme proposait la réduction du nombre de parlementaires représentant un signe important de ce renouveau en parallèle d’une augmentation d’institutions plus transversales et directes. Cette réduction était corrélée à l’abaissement du seuil de saisine du Conseil constitutionnel. La justice était aussi concernée par cette réforme pléthorique avec la consécration d’une véritable indépendance du parquet, et la suppression de la juridiction d’exception pour les ministres, la Cour de Justice de la République. Cette réforme transversale abordait aussi la question des collectivités ; en particulier la question de la Corse par la reconnaissance de sa spécificité ; puis de manière secondaire en proposant un droit à la différenciation pour les collectivités locales. L’un des points majeurs de ce renouveau est la transformation du Comité Économique Social et Environnemental (C.E.S.E) en une chambre de la société civile ayant pour but de faire de celui-ci le représentant de la démocratie participative et d’en être l’organisateur et le gestionnaire (modification des mandats, des compétences).
Dans un second temps, c’est la réaction de l’Exécutif face à l’échec de son texte qui représente une posture novatrice dans l’histoire des révisions de la Vème république. Ce dernier ne l’a pas laissé choir dans les archives de l’Assemblée, mais est passé par deux lois organiques[10]. Ces deux lois permettent de sauver certaines idées de la réforme qui ne nécessitait pas obligatoirement une révision du texte constitutionnel. Ces deux lois organiques ont été placées sur la table de l’Assemblée nationale pendant l’été 2020, et ont été discutées en septembre pour la première, et en mars pour la seconde, avant d’être validées par le Conseil constitutionnel. Or, la loi organique est une loi prévue par la Constitution qui a pour objet de préciser ou de compléter certains articles de la Constitution (à titre d’exemple le nombre de parlementaires et la procédure de QPC). À ce titre, la première réformant le CESE interroge, puisqu’elle reprend à son compte (en partie), la volonté réformatrice de l’Exécutif, tout en passant par une voie différente.[11] Ironie de la matière constitutionnelle, le référendum de 1969 qui fut rejeté, prévoyait lui aussi une modification du CESE et du Sénat (fusion des deux instances), l’Exécutif de 2021 allant plus loin que l’exécutif des années 1970[12]. La seconde loi organique renforce le principe de différenciation territoriale, alors que la loi constitutionnelle prévoyait de supprimer le délai d’expérimentation (suppression du mot « Et d’une durée limitée »), la loi organique permet un cadre réglementaire expérimental selon certaines conditions. Et, permettant à cette expérimentation à terme de se pérenniser, concernant les règles relatives à l’exercice de leurs compétences pour tenir compte de leurs spécificités[13].
Ces méthodes appellent à deux observations. La première consiste à se demander si nous ne pourrions y retrouver là, une hiérarchie des organes constitués : alors que le Conseil constitutionnel, ou le Parlement ne pourrait se voir modifier ainsi ses compétences et son but, le CESE peut voir ses prérogatives amendées par la « simple » loi organique. Nous pourrions voir aussi une corrélation entre la spécificité du CESE et sa discrétion à l’égard du public non-averti qui sera moins touché que par une réforme institutionnelle du Parlement ou du Conseil constitutionnel. Cependant, il semble contraire à la lettre de la Constitution que de raisonner ainsi, et ceci appelle à une seconde observation. Celle-ci consiste à critiquer la technique normative utilisée[14] : si la Constitution a prévu l’existence de la loi organique ce n’est pas pour se substituer à celle-ci, mais pour la compléter. A ce titre, l’habilitation par loi organique pour le CESE ne concerne que certaines modalités, dont la composition de ses membres ou les modalités de la saisine citoyenne. En ajoutant une nouvelle compétence au CESE par la voie organique, l’ensemble des organes constitués principaux (Parlement et Exécutif) contournent le principe de révision, créant une convention infra-constitutionnelle pour permettre de répondre aux objectifs politiques fixés (et il en est de même avec l’exemple du droit à la différenciation territoriale). Le droit représentant un simple outil pour régler une stratégie politique, et non plus un cadre à l’intérieur duquel agir[15], utilisant les règles plus aisées de la loi organique de l’article 46, que de la révision constitutionnelle de l’article 89. Cette facilité est renforcée lorsque le Conseil constitutionnel devient moins regardant au fil des nominations les rapprochant de la majorité en place[16]. Dévoiement de l’outil de révision ou ignorance des conséquences juridiques, rien en droit ne justifiait de passer par la loi organique pour consacrer la compétence de convocation de conventions citoyennes en lieu et place d’une révision constitutionnelle par le biais de l’article 89 ; bien que tout le justifiait en politique.
II. En parallèle de l’adoption des deux lois organiques, il fut proposé au Parlement, un deuxième projet de révision constitutionnelle.Ce deuxième projet fut déposé en janvier 2021 au Parlement. De son contenu, il ne comporte qu’un article unique reprenant le premier article du projet de 2018. Cette reprise, n’est pas sans une amélioration de l’article initialement proposé. Il incorpore les propositions de la convention citoyenne sur l’environnement. Le texte déposé introduit à l’article 1er de notre Constitution le principe selon lequel la France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »[17]. Nous voyons ici la différence avec le projet de 2018 qui ne prévoyait qu’une garantie de « préservation de l’environnement». Bien que nous pourrions considérer que les deux formulations sont similaires, la seconde englobant l’ensemble des termes de la première (comment préserver l’environnement si nous ne luttons pas contre le dérèglement ?) .
Cette reformulation n’a cependant pas suffi pour convaincre et aboutir à un consensus entre les parlementaires des deux chambres. C’est une parfaite illustration de ce qui a été développé dans l’introduction. Cette volonté de rejet du Sénat concernant le texte d’amendement, voir un veto pour des motifs politiques comme juridique[18], empêche un accord potentiel avec l’Assemblée nationale. Cette impossibilité fut si marquée, que le texte fut retiré par le gouvernement.
Élément intéressant, le chef de l’État s’était engagé à soumettre ce projet au référendum lors de son engagement du 14 décembre 2020 devant la Convention citoyenne pour le climat. Toutefois, les deux assemblées n’ayant pas réussi à voter le texte dans des termes identiques au bout de deux lectures, le Premier ministre a annoncé, le 6 juillet 2021, l’abandon du processus de révision constitutionnelle et donc du référendum. Il semble cependant qu’il n’était pas tenu juridiquement par cette annonce à passer par la voie référendaire, seul comptant le choix postérieur au vote des deux assemblées, comme l’indique le texte constitutionnel.
III. Partant, le chef de l’État, ayant pris acte de ces deux échecs et de sa réélection à la présidence de la République, a annoncé une nouvelle tentative d’amendement constitutionnel. D’emblée, l’annonce marque un changement de ton employé : « trouver un texte accordant les points de vue entre l’Assemblée nationale et le Sénat »[19]. L’heure est à l’accord trans-partisan « cohérant et conséquent »[20], tels sont les mots du chef de l’État.
Pour réussir à trouver cet accord, le président de la République semble vouloir porter une nouvelle étape en direction de la décentralisation pour s’accorder avec le Sénat, où il a confié une mission d’analyse confiée au questeur de l’Assemblée nationale Éric Woerth, et en confiant une question sur la fiscalité locale à deux députées en parallèle de son annonce. Il a également annoncé le retour d’un des projets de 2018 : l’élargissement du champ du référendum de l’article 11 et la simplification du Référendum d’initiative partagée, jugé trop contraignant. Pour le premier, le projet est abandonné après seulement un mois de négociation, faute de consensus politique à la suite des rencontres inter-partis organisées par le président.
En outre, revenant du substratum de la réforme de 2018, le président érige le statut autonome de la Corse comme ambition constitutionnelle. Il souhaite prendre en compte son particularisme, et corrélativement étendre aux outre-mer cette autonomie qui se voudrait graduelle (notamment pour la Nouvelle-Calédonie ou la Guadeloupe) : « Indivisible ne signifie pas uniforme. L’idéal républicain est assez fort pour accueillir les adaptations, les spécificités, les particularités. ». Cette réforme constitutionnelle entraînerait nécessairement une refonte de la position du Conseil constitutionnel qui protège, pour le moment, le principe d’indivisibilité et d’unicité du peuple français[21]. C’est ainsi que la collectivité territoriale corse ne peut ni dévier du principe d’indivisibilité, ni du principe d’égalité des citoyens, et doit respecter les compétences étatiques. En portant le particularisme corse au niveau constitutionnel, en l’inscrivant noir sur blanc dans notre texte le plus haut de l’ordre juridique interne, le président forcerait une adaptation d’une conception stable de notre République, qui pourrait être considéré par le Conseil constitutionnel comme un principe inhérent à notre identité constitutionnelle.
Dernier point de révision, c’est l’inscription au sein de la constitution du droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution qui avait déjà fait son apparition dans plusieurs propositions de loi constitutionnelle l’année dernière et qui est toujours en cours de discussion (la proposition a été renvoyé devant la commission des lois de l’Assemblée nationale). Cette inscription est une réponse directe à l’arrêt Dobbs de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, et de l’inquiétude liée à une éventuelle décision similaire en France. Pour que son intégration soit possible, deux interrogations se posent :
La première consiste dans la manière de l’intégrer : les propositions prévoyaient d’ajouter un article 66-2, à la suite de l’article 66 protégeant la liberté individuelle et l’interdiction d’une détention arbitraire, et de l’article 61-1 concernant l’interdiction de la peine capitale. Or, notre constitution est une constitution procédurale plus qu’une constitution protectrice des droits fondamentaux[22], c’est pour cela que les sages furent obligés d’élargir les normes de références au préambule puis à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de consacrer des nouveaux principes (tels que les PFRLR ou les RPIIC). Aujourd’hui, du fait de la présence d’un ensemble des textes et principes qui composent les normes de référence de notre contrôle de constitutionnalité, ou plus vulgairement « bloc de constitutionnalité », et notamment la déclaration des droits de 1789, une idée apparaît de manière transversale : pour intégrer de nouveaux droits, ne serait-il pas possible de modifier la déclaration de 1789 ou le préambule de 1946 ? Deux textes indépendants de leur moment de création, porteurs de droits et libertés et modernisés par l’interprétation du Conseil constitutionnel. Il semble que ce soit une possibilité qui devrait être débattue pour répondre à une partie des inquiétudes, notamment de ceux s’opposant à l’intégration de droits au sein de la Constitution du 4 octobre 1958.
Cependant une telle procédure serait créée ex nihilo : rien de la jurisprudence du conseil ou du texte constitutionnel ne prévoit une telle procédure de révision. Il faudrait alors, pour le constituant, considérer que les normes de référence constitutionnelles (D.D.H.C., Préambule de 1946) sont incluses dans la procédure de révision de l’article 89. Une ébauche de réponse se trouve peut-être au niveau de la Charte de l’environnement, un texte devenu une norme de référence positive par le renvoi au sein du préambule de 1958, qui fut adopté par la procédure de l’article 89 de la Constitution de 1958. De surcroît, en observant le titre de l’article : « De la révision » et son contenu, aucun des deux ne précisent que la révision doit porter uniquement sur le texte de 1958. Premier élément en faveur d’un amendement des normes de référence, c’est a minima une solution à explorer pour permettre une meilleure précision de nos textes constitutionnels qui sont tous éloignés sur le plan temporel, et pourtant appliqués uniformément sur le plan des droits et libertés.
La seconde consiste dans l’hésitation sur la consécration de l’IVG : l’Assemblée souhaitait la consécration d’un droit, alors que le Sénat a amendé la proposition de loi constitutionnelle pour le transformer en une liberté. Car bien que la forme semble être identique, la différence est sémantique :
« Le droit à l’IVG, c’est la garantie que si une personne le souhaite ou si c’est nécessaire, elle pourra procéder à une interruption volontaire de grossesse. La liberté est garantie par la loi, alors que le droit doit être garanti en lui-même.« [23]
Le président qui souhaite accélérer l’adoption de cet amendement devra trancher, pour proposer ou orienter la majorité pour déterminer, avec l’ensemble des forces politiques, lequel du droit ou de la liberté l’emportera. Si la liberté l’emporte, les personnes qui souhaiteront avorter, seront toujours sous la menace d’une restriction de leurs droits par les parlementaires. À l’inverse un droit permettra à chacun de pouvoir en profiter sans qu’il soit menacé. Élément intéressant, le projet de loi constitutionnelle actuellement débattu en Conseil des ministres semble s’orienter vers une liberté de l’interruption volontaire de grossesse. De ce choix, peut-être que le meilleur décideur serait les femmes elles-mêmes, et non une classe politique à majorité masculine ou encore le peuple français via le référendum. Comme évoqué, tout rejet sur cette question pourrait entraîner un grave recul sur nos questions de sociétés, cette crainte est couplée avec le futur débat sur la fin de vie qui doit se tenir lieu au milieu de l’année 2024.
* *
*
En conclusion, une potentielle réforme constitutionnelle fait face à des obstacles demeurants difficilement surmontables. Partant d’un accord du Sénat et de l’Assemblée nationale sur un même texte, puis de l’adoption par le Congrès ou par référendum, le Président devra réussir à produire un texte unificateur qui risque de relancer de nombreuses questions de sociétés. De surcroît, il est concurrencé par les propositions de loi constitutionnelle plus ou moins sérieuses. Mais pour le chef de l’État, « préserver [la Constitution], ce n’est pas la figer », c’est peut-être une volonté de marquer un changement d’ère. De la constitution stable, mais révisée de manière ordinaire, son contenu semble être questionnable et la vigilance autour de cette révision doit être effectuée par chacun. Ces changements constants semblent bien éloignés des pensées de l’Assemblée constituante de 1791 qui pensait à un texte immuable :
« La Déclaration des droits est en tête de notre travail, telle qu’elle a été décrétée par l’Assemblée. Les comités n’ont pas cru qu’il leur fût permis d’y faire aucun changement. Elle a acquis un caractère religieux et sacré ; elle est devenue le symbole de la foi politique ; elle est imprimée dans tous les lieux publics, affichée dans la demeure des citoyens à la campagne, les enfants y apprennent à lire. Il serait dangereux d’établir en parallèle une déclaration différente, ou même d’en changer la rédaction. »[24]
Paul Vassal
Master 2 – Droit constitutionnel et droits fondamentaux, Président de l’A.E.D.C.,
Vice-Président de l’Association des publicistes de la Sorbonne
[1] MACRON (E.), Discours devant le Conseil constitutionnel, 4 octobre 1958. Pour une retranscription voir : https://francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/direct-vers-une-reforme-de-la-constitution-suivez-le-discours-d-emmanuel-macron-a-l-occasion-du-65e-anniversaire-du-texte_6098937.html
[2] Pour un exemple de conséquences, la réforme constitutionnelle pour l’instauration du nouvel échelon territorial rejetée par référendum de 1969 : « Les conséquences du refus du projet de 1969 ont été très lourdes. Cet échec a pesé sur toutes les réformes ultérieures. La hantise de l’échec a plané sur les pouvoirs publics, qui ne se sont décidés qu’avec une extrême prudence à parler de la région. Certains commentateurs ont même pensé, après 1969, que l’idée d’une collectivité régionale était définitivement condamnée. », PONTIER (J-M.), Encyclopédie des collectivités locales, Chapitre 1 (folio n°1710) – Région : collectivité régionale Coll. loc., Mai 2022, n°77.
[3] BARANGER (D.), La constitution : sources, interprétations, raisonnements, Dalloz, 13 juillet 2022, p.207
[4] Ibid
[5] Le Scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République avec une majorité requise de 538, et le nombre de votant en faveur de l’adoption était de 539, pour plus de détails : https://www.assembleenationale.fr/13/scrutins/jo9001.asp
[6] Sur les difficultés de la majorité élue, voir le nombre de 49-3 déployé depuis la réélection d’Emmanuel Macron : « Avec dix-huit recours en dix-huit mois, le gouvernement borne banalise l’article 49-3 », https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/11/23/avec-dix-huit-recours-en-dix-huit-mois-le-gouvernement-borne-banalise-l-article-49-3_6199896_4355771.html
[7] Pour une explication plus en détails de la crise politique, voir : VAUDANO (M.) et BARUCH (J.), « Delevoye, Rugy, Goulard, Benalla… les affaires qui ont ébranlé le quinquennat d’Emmanuel Macron », Le Monde, 12 juillet 2019.
[8] Pour plus de détail, voir infra.
[9] Pour un exposé plus précis du texte de loi, et du dossier législatif, voir : https://www.vie-publique.fr/loi/273301-reforme-constitutionnelle-2019-pour-un-renouveau-de-la-vie-democratique
[10] En ce sens, voir : Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution concernant le principe de différenciation territorial; et LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental concernant le Comité Économique Social et Environnemental.
[11] A titre d’exemple, le projet abandonné de réforme prévoyait « Le (CESE) organise la consultation du public afin de lui permettre d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux, en particulier économiques, sociaux et environnementaux, des décisions des pouvoirs publics et sur leurs conséquences à long terme. (…) il peut réunir des conventions de citoyens tirés au sort. », l’article 4 de la LO n°2021-467 prévoit « Pour l’exercice de ses missions, le CESE peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public ». Preuve que le CESE voit ses compétences et fonctions augmentées.
[12] VALETTE (J.-P.), La dynamique du pouvoir exécutif sous la Ve République (1958 -1993), L’Harmattan, 2020, p. 435
[13] Pour voir les similitudes dans les idées, voir : Projet d’amendement constitutionnel déposé en 2018 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2203_projet-loi), et Loi organique du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043399222/2021-04-21/)
[14] BARANGER (D.), « L’inopportune réforme du CESE », Jus Politicum Blog, 5 septembre 2020, https://blog.juspoliticum.com/2020/09/05/democratie-participative-linopportune-reforme-du-cese-par-denis-baranger/
[15] Pour une critique du cadre juridique entourant le politique, voir : GUENAIRE (M.) « La constitution ou la fin de la politique », Le débat, Gallimard 1991/2 n° 64 | pages 146 à 153, (https://www.cairn.info/revue-le-debat-1991-2-page-146.htm)
[16] Pour une critique du Conseil constitutionnel plus complète, voir : GUTTMANN-FAURE (U.), « Transformer ou… transformer le Conseil constitutionnel, une opinion du Pr. Agnès Roblot-Troizier. « L’indispensable mue du Conseil constitutionnel », bref résumé ». Brève d’actualité de l’Association des étudiants en droit constitutionnel de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le 1er novembre 2023.
[17] Pour un exposé des motifs plus complet sur ce projet de loi, voir le dossier législatif : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3787_projet-loi
[18] VALETTE (J.-P.), La dynamique du pouvoir (…), op. cit., p.435
[19] Voir supra : MACRON (E.), Discours devant le Conseil constitutionnel, 4 octobre 1958.
[20] Ibid.
[21] En ce sens, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est assez univoque : C. cst., 15 juin 1999, décision n°99-412, portant sur la Charte Européenne : « ces principes fondamentaux (Indivisibilité et unicité) s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » ; et C. cst., 9 mai 1991, 91-290 DC, portant sur le statut de la Corse : « la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion. »
[22] Pour une constitution protégeant des droits fondamentaux, nous vous conseillons d’observer la Constitution de l’Équateur, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/17156, et celle du Brésil : https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/11795.
[23] PHILIP-GAY (M.), maître de conférence en droit public in « Le « droit » devenu « liberté » : que change la formule choisie par le Sénat pour constitutionnaliser l’IVG ? », Radio France, 2 février 2023.
[24] Déclaration du député Jean‑Guillaume Thouret à l’Assemblée constituante, le 8 août 1791.