« L’indispensable mue du Conseil constitutionnel », bref résumé.
Par Ulysse Guttmann-Faure
Une mue du Conseil constitutionnel devenue « indispensable » : voici donc l’idée que défend1 la Professeure de Droit public Agnès Roblot-Troizier dans une « opinion » publiée en ligne sur le site du Club des juristes. Ainsi, la Directrice de l’Ecole de droit de la Sorbonne fait le choix de reprendre l’usage d’un terme habituellement utilisé au passé2. En effet, avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ou par l’addition des processus de « juridictionnalisation » du Conseil, ce « renouvellement partiel ou total »3 de l’institution a pu être considéré comme achevé, ou suffisant.
Tel n’est manifestement pas l’avis de la Pr. Roblot-Troizier qui, loin de se satisfaire du chemin parcouru par le Conseil constitutionnel4, décèle une « double ambiguïté congénitale » à laquelle il conviendrait de répondre, aujourd’hui plus que jamais.
I. La première ambiguïté serait relative au Conseil constitutionnel lui-même. Les critiques sont connues ; la première concerne la composition de l’institution de la rue de Montpensier. Ce faisant, une contradiction subtile est décelée entre, d’une part, la volonté constante du Conseil d’apparaître comme une juridiction et, d’autre part, des autorités politiques feignant de ne pas le considérer comme tel afin de laisser perdurer leur quasi-totale liberté de nomination, le contrôle des parlementaires étant par ailleurs qualifié de « mascarade ».
- Aussi, une réponse évidente pourrait résulter de la transformation de l’institution.
Celle-ci nécessiterait d’abord un changement dans la composition du Conseil en mettant au cœur de la nomination de chaque membre ses compétences juridiques (à l’appui de « qualifications juridiques les plus hautes » et d’un nombre « substantiel » d’années d’expérience). Pour la constitutionnaliste en effet, le problème tient moins des autorités de nomination que des raisons justifiant lesdites nominations. Sans souhaiter l’automatique disparition des femmes et hommes politiques des membres du Conseil, ni l’apparition d’une cour de professeurs, un renforcement des exigences d’indépendance et d’impartialité5 des membres est aussi revendiqué. - Corrélativement, Agnès Roblot-Troizier propose un bouleversement de
l’organisation du Conseil en défendant la création de sorte de cabinets de juristes attachés à chaque membre6, pouvant s’appuyer sur un service de recherche et documentation. - Enfin, les décisions rendues ne sont pas exemptes de critiques, notamment
concernant leur brièveté et la qualité de leur motivation. Pour y répondre, la possibilité de publier des opinions séparées est régulièrement avancée par une partie de la doctrine, universitaire7 comme organique8 , sans qu’un consensus ne semble émerger9 . À ce propos, Professeure Roblot-Troizier constate qu’une telle pratique est « étrangères à nos traditions » et que des développements plus longs et une justification plus étayée seraient déjà, a minima, une piste d’amélioration importante. En ce sens, deux aspects sont particulièrement mis en avant : « l’abandon des motivations standardisées […] et des raisonnements circulaires10» .
II. De surcroît, outre celle relative à la composition du Conseil, la seconde ambiguïté serait apparue de manière évidente avec l’instauration d’une QPC ayant joué le rôle de miroir grossissant. En deux mots, la vérification d’une norme législative au regard de normes à valeurs constitutionnelles, contrôle abstrait, serait en décalage avec la demande faite in concreto par des justiciables alléguant une violation subjective de leurs droits… Face à ces deux constats affectant l’aile gauche du Palais-Royal, une évolution serait aujourd’hui devenue inévitable : soit à propos de l’institution, comme il vient d’être vu, soit et à défaut, quant à ses compétences.
III. Dans son alternative aux « mutations [institutionnelles] profondes » qu’elle appelle de ses vœux, la Professeure semble tirer les conséquences de l’immobilisme actuel. Ainsi est-il proposé de revoir fondamentalement les compétences dévolues aux « sages » en ce que le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois serait confié aux juges judiciaires et administratifs, déjà chargés du contrôle de conventionnalité11. Quant à lui, le Conseil constitutionnel deviendrait ainsi une sorte de « Tribunal des conflits constitutionnels », uniquement chargé des conflits de jurisprudences entre les juridictions suprêmes des deux ordres, en plus de ses autres compétences historiques (contrôle a priori, juge électoral, des opérations référendaires ou encore dans le cadre des procédures des articles 16, 37 al. 2 et 41,…). Alors que les juges dits « ordinaires » ne pourraient qu’écarter les lois considérées comme contraires à la Constitution, le Conseil resterait, en revanche et en toute logique, le seul à pouvoir les retirer de l’ordre juridique, notamment en cas de fort risque d’insécurité juridique. Faute de changements faisant du Conseil constitutionnel une véritable juridiction alignée sur les standards internationaux modernes, c’est ainsi une route différente de celle prise en 2008 qui serait empruntée. Si, pour certains, la proposition est volontairement provocatrice, il subsiste que le Conseil conserverait ainsi ses missions de contrôle des conflits politiques et, dans le même temps, deviendrait un interlocuteur direct des deux ordres juridiques qui pourront le saisir dans le cadre de leur nouvelle compétence de contrôle de la constitutionnalité des lois en vigueur. Le dialogue des juges — formel cette fois-ci — en sortirait vivement renforcé.
Rejetant tout statu quo, la Professeure Agnès Roblot-Troizier considère en tout état de cause que le Conseil est aujourd’hui à la croisée des chemins : « Soit le Conseil constitutionnel reste intact et il faut revoir ses titres de compétences ; soit il subit une mutation profonde ». Les critiques appelant des réponses, en voilà deux, dans des directions opposées, participant activement au débat. Les projets de révision de la Constitution formulés par le Président Emmanuel Macron viendront-ils manifester sa préférence ? Affaire à suivre…
Ulysse Guttmann-Faure,
Master II Droit constitutionnel et droits fondamentaux, Responsable du Pôle Recherche,
Représentant des « usagers » au Conseil de Gestion de la Fondation Panthéon-Sorbonne.
1 — ROBLOT-TROIZIER Agnès, « L’indispensable mue du Conseil constitutionnel », 17/10/2023 , https://www.leclubdesjuristes.com/justice/lindispensable-mue-du-conseil-constitutionnel-1081/ — consulté le 19/10/2023.
2— Du moins concernant la presse généraliste : en date du 11/03/2022, « Le Conseil constitutionnel fait sa mue en juge constitutionnel », Le Monde. Pour le journal La Croix, « Le Conseil constitutionnel achève sa mue » en date du 24/02/2010.
3— « Renouvellement partiel ou total de la peau, des poils ou des plumes d’un animal sous l’influence de la croissance, de l’âge et des conditions du milieu », première définition formulée par le Larousse à propos du nom féminin « mue », qui n’a probablement pas été choisi au hasard.
4— De la décision du 16 juillet 1971 (au support, déjà, d’une interprétation assez éloignée de l’intention du constituant de 1958 portée le Conseil lui-même) à la révision de 1974 ; de l’utilisation du contrôle a priori comme « arme » politique à l’introduction d’un contrôle a posteriori permettant une augmentation encore plus forte du nombre des décisions, la redécouverte des fonctions historiques du Conseil et le contrôle d’une loi dite « vivante » dans un rôle de gardien des droits fondamentaux.
5-À ce propos, voir les très interessants développements de la thèse « L’impartialité du Conseil constitutionnel », par Alexia DAVID (soutenance 12/01/2021 ; dir. J.-M. LARRALDE et M.-J. REDOR-FICHOT).
6 — Une proposition évidemment saluée ici, pour les perspectives de stage qu’elle pourrait faire naître…
7— En 2000 déjà, Dominique ROUSSEAU : « »Pour » : Une opinion dissidente en faveur des opinions dissidentes », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 8, juillet 2000, p. 113. Mais aussi Diane ROMAN, « Le droit et l’espoir, à propos des opinions séparées du juge Pinto de Albuquerque ». Droits de l’Homme. Les opinions séparées vues par la doctrine, Lexis Nexis, pp.121-126., 2020, ou encore les différentes publications de Wanda MASTOR (notamment sa thèse soutenue en 2001, dir. LouisFAVOREU, ou plus récemment : « Les opinions séparées sont-elles raisonnables ? », Cahiers de méthodologie juridique, RRJ
2015-5).
8— Concernant le Conseil constitutionnel, voir la position de Pierre JOXE (2001-2010) dans : Cas de conscience, Pierre Joxe, Labor et Fides, 2010. Plus récemment, nous remercions la Professeure ROBLOT-TROIZIER de nous voir indiqué la position de la membre du Conseil constitutionnel (2013-2022) Nicole MAESTRACCI en ce sens : Rapport d’activité 2021 du Conseil constitutionnel, p. 23. Concernant la Cour de cassation, une réflexion serait en cours (« Rentrée 2023 – Allocution de Christophe Soulard, premier président », 9 janvier 2023), à la suite du rapport « Cour de cassation 2030 » publié en juillet 2021.
9— Parmi la doctrine constitutionnelle organique, la position majoritaire étant plutôt celle d’une opposition à la publication d’opinions séparées. Voir par exemple « La transposition des opinions dissidentes en France est-elle souhaitable? « Contre » : le
point de vue de deux anciens membres du Conseil constitutionnel », François LUCHAIRE, Georges VEDEL, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 8, juillet 2000, p. 111. Plus récemment, voir l’opposition de l’actuel Président du Conseil : « Fabius : “si
les révisions sont bloquées, la Constitution peut s’affaiblir” », Le Monde, 26 septembre 2018.
10— Sur cette question passionnante, qu’il soit permis de renvoyer les intéressés à l’article fleuve du Professeur Denis Baranger publié en mai 2012, « Sur la manière française de rendre la justice », Jus Politicum. En ligne : https://juspoliticum.com/
article/Sur-la-maniere-francaise-de-rendre-la-justice-constitutionnelle-478.html.
11- Exerçant également, par ailleurs, un certain contrôle de la constitutionnalité « manifeste » dans leur office de juge du filtre ainsi que lors du contrôle des normes infra-législatives.
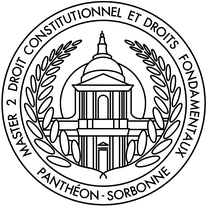

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.